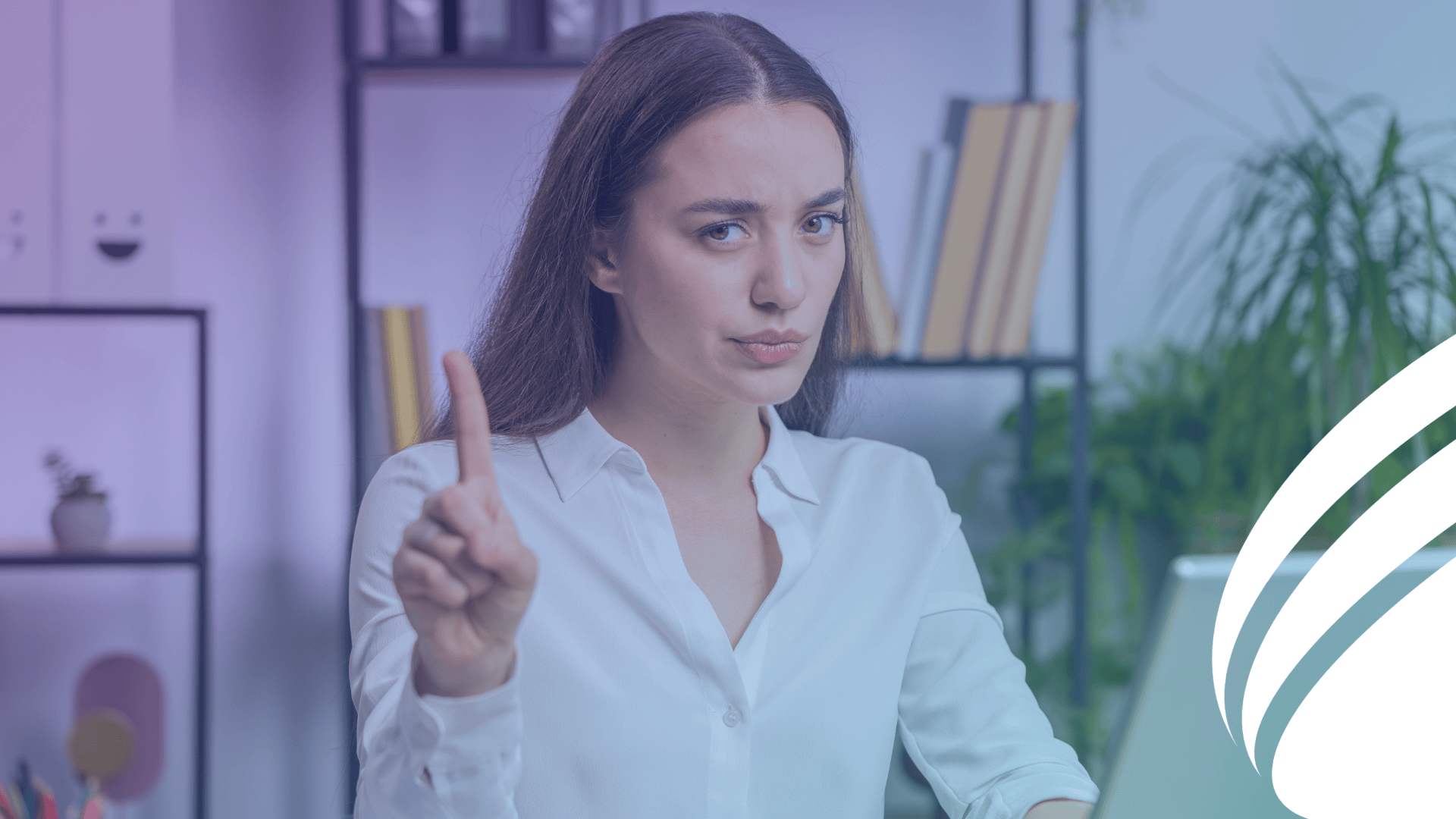
Recruter un bon candidat ne garantit pas forcément une collaboration réussie. Malgré des processus formalisés, des CV impressionnants et de nombreux entretiens, les erreurs de recrutement restent fréquentes.
D’après une étude menée par Leadership IQ, 65 % des recrutements échouent dans les 18 mois, non pas à cause d’un manque de compétences techniques, mais à cause des lacunes comportementales, culturelles ou motivationnelles,
Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Et surtout, comment l’éviter ?
Une définition floue du "bon candidat"
Derrière chaque recrutement raté se cache souvent un brief trop vague ou trop consensuel. On
veut "un profil autonome, dynamique, capable de gérer la pression", mais sans jamais définir ce que cela signifie concrètement dans le contexte de l’équipe.
Le risque : recruter un candidat qui coche des cases génériques, mais qui n’est pas aligné avec la réalité du poste ni avec les attendus implicites de l’équipe ou du manager.
Ce qu’il faut faire : définir des critères de succès clairs, spécifiques et mesurables. Ces critères doivent être élaborés en collaboration avec les parties prenantes (manager, équipe, etc.) afin de garantir leur pertinence et leur acceptation.
Par exemple, ces critères pourraient inclure : " la capacité à prendre des décisions techniques de manière autonome après trois semaines " ou "être capable d'animer une réunion client en anglais dès le deuxième mois"..
La définition et le suivi régulier de ces critères permettront non seulement d'évaluer l'intégration et la performance de la nouvelle recrue, mais aussi d'ajuster les actions d'accompagnement si nécessaire.
Des biais d’évaluation omniprésents
Même les recruteurs les plus aguerris, forts de leur expérience et de leur expertise, ne sont pas totalement à l'abri des biais cognitifs. Ces raccourcis mentaux, bien que souvent inconscients, peuvent fausser le jugement et altérer significativement l'évaluation objective d'un candidat, surtout lors d’entretiens non structurés.
Parmi les biais les plus courants, on retrouve l'effet de halo, où une caractéristique dominante chez le candidat (par exemple un charisme évident) tend à influencer la perception globale de toutes les autres compétences.
Le risque : on surévalue les "bons communicants" et on sous-estime les profils plus réservés mais tout aussi compétents.
Ce qu’il faut faire : adopter une approche structurée, des grilles d’entretien standardisées, diversifier les méthodes d’évaluation (tests, mises en situation, feedbacks croisés) et former les recruteurs aux biais de jugement.
Ces méthodes permettent d'évaluer non seulement les compétences techniques, mais aussi les compétences comportementales et l'adéquation culturelle avec l'entreprise.
La culture d’entreprise, grande absente du processus
Les descriptions de poste omettent souvent des aspects cruciaux tels que la culture managériale, le mode de communication prédominant ou le niveau d'autonomie réel attendu. Or, c’est souvent le décalage culturel qui est à l'origine des ruptures de contrat durant la période d'essai.
Par exemple : Un individu très méthodique pourrait se sentir submergé par un environnement d'entreprise agile et en constante évolution. Ou bien, un profil très autonome pourrait se sentir par une structure hiérarchisée.
Ce qu’il faut faire : intégrer une évaluation de l’adéquation culturelle dès les premières étapes du processus..Cela peut se faire à travers des questions ciblées lors des entretiens, qui permettent de sonder la manière dont ils gèrent les conflits, leur approche du travail en équipe, ou leurs préférences en matière d'environnement de travail.
Au-delà des questions, les outils psychométriques peuvent offrir une vision plus approfondie de la compatibilité du candidat avec la culture d'entreprise, les valeurs et le style de leadership en place. L'objectif est d'identifier non seulement si le candidat possède les compétences techniques requises, mais aussi s'il s'épanouira et contribuera positivement à l'environnement de travail existant.
L’onboarding sous-estimé
Un recrutement, même s'il semble parfait sur le papier et que le candidat possède toutes les compétences requises, est voué à l'échec si son intégration au sein de l'entreprise n'est pas réussie. Le manque d’accompagnement, la désorganisation du parcours d’arrivée ou l’absence de feedback peuvent rapidement démotiver un nouvel entrant.
Le risque : Sans plan clair ni points de contact réguliers, avec son manager et ses collègues, le nouveau salarié aura du mal à trouver sa place au sein de l'équipe et de la culture d'entreprise.
Ce qu’il faut faire : Mettez en place un programme d'intégration détaillé, jalonné par des étapes clés (ex: première semaine, premier mois, troisième mois). Intégrez le collaborateur à des rituels d’équipe pour l’aider à créer du lien, et surtout mettez en place un suivi personnalisé pendant les 3 premiers mois et l'accompagner dans la montée en compétences.
Ce qu’on peut faire pour réduire les erreurs
Pour réduire significativement les erreurs de recrutement, il est essentiel d'adopter une approche plus stratégique, allant au-delà du simple "mieux recruter". Cela implique une combinaison de trois éléments clés :
- L'utilisation d'outils fiables : Pour une évaluation précise des compétences techniques et comportementales des candidats.
- Une compréhension approfondie du poste : Identifier les facteurs de succès spécifiques qui mènent à la réussite dans la fonction.
- L'intégration et l'adéquation : Accorder une attention particulière à l'alignement entre le profil du candidat, l'équipe existante et la culture de l'entreprise.
L’objectif n’est pas de viser le zéro défaut, mais de diminuer l’incertitude… grâce à des données, de l’analyse, et un peu d’humilité sur nos biais humains.





